L'eau dure contient de fortes concentrations de calcium, de magnésium et d'autres sels minéraux qui, lorsqu'ils sont chauffés et évaporés, peuvent former des dépôts de tartre sur les surfaces des échangeurs de chaleur du condenseur refroidi à l'eau. Au fil du temps, ce tartre agit comme une barrière isolante entre l'eau de refroidissement et les surfaces métalliques du condenseur, ce qui nuit à l'efficacité de l'échange thermique. À mesure que le tartre s'épaissit, il faut plus d'énergie pour obtenir le même effet de refroidissement, ce qui entraîne une efficacité réduite du système, des coûts d'exploitation plus élevés et une usure accrue du système. L’accumulation de tartre peut également entraîner une réduction de la capacité de débit à l’intérieur du condenseur, entraînant des pressions et des températures plus élevées. Pour lutter contre ces effets, de nombreux condenseurs refroidis à l'eau utilisent des adoucisseurs d'eau qui éliminent les ions calcium et magnésium, ou utilisent des produits chimiques antitartre pour inhiber la formation de tartre.
Une eau de qualité présentant des niveaux de pH extrêmes (trop acides ou trop alcalins) peut entraîner la corrosion des composants métalliques de l'eau. condenseur refroidi à l'eau . L'eau à faible pH (acide) peut provoquer une oxydation des surfaces métalliques, entraînant la rouille et affaiblissant l'intégrité structurelle du condenseur, tandis que l'eau à pH élevé (alcaline) peut provoquer une corrosion alcaline, qui détruit les surfaces métalliques. La présence de chlorures, souvent présents dans l’eau de mer ou dans l’eau de refroidissement industrielle, peut accélérer la corrosion par piqûre, entraînant des dommages localisés. Pour prévenir la corrosion, l'eau doit être traitée pour maintenir une plage de pH optimale, généralement comprise entre 7 et 8,5, ce qui est idéal pour prévenir la corrosion acide et alcaline. Les inhibiteurs de corrosion, tels que les phosphates, les composés de zinc ou les silicates, sont couramment utilisés conjointement avec des analyses régulières de l'eau pour garantir que la qualité de l'eau se situe dans des limites tolérables.
Les sources d'eau qui contiennent des sédiments, de la saleté ou d'autres particules peuvent entraîner des obstructions et des blocages dans les systèmes de tuyauterie et d'échangeur de chaleur du condenseur refroidi à l'eau. Ces particules solides peuvent obstruer l’écoulement de l’eau, réduisant ainsi sa capacité à évacuer la chaleur du condenseur. Le débit réduit augmente la pression à l’intérieur du condenseur et diminue son efficacité globale de refroidissement. Au fil du temps, l'accumulation de sédiments peut entraîner une usure abrasive des composants internes, augmentant encore les besoins de maintenance et le risque de panne. Pour atténuer ces problèmes, des systèmes de filtration ou des crépines sont généralement installés aux points d’entrée d’eau pour capturer les grosses particules avant qu’elles n’entrent dans le condenseur. Ces systèmes sont conçus pour éliminer le sable, le limon et autres solides en suspension qui pourraient endommager les composants internes ou réduire les performances.
Le bioencrassement se produit lorsque des micro-organismes, tels que des bactéries, des algues et des champignons, s’accumulent sur les surfaces d’échange thermique du condenseur. Lorsque rien n’est fait, ces micro-organismes peuvent former un biofilm qui agit comme une couche isolante qui altère considérablement le transfert de chaleur. Le biofilm favorise également la corrosion et le colmatage, diminuant encore davantage l'efficacité du système. L'encrassement biologique est plus fréquent dans les systèmes utilisant des eaux de surface (rivières, lacs ou eau de mer) qui contiennent des niveaux plus élevés de matières organiques. La croissance des algues est particulièrement problématique car elle peut bloquer le débit d'eau et entraîner une augmentation de la consommation d'énergie, le système compensant l'efficacité réduite du transfert de chaleur. Pour lutter contre l'encrassement biologique, les systèmes de traitement de l'eau incluent souvent des biocides chimiques (tels que des composés à base de chlore, de brome ou de cuivre) qui tuent les micro-organismes avant qu'ils ne puissent établir un biofilm. Le traitement par la lumière ultraviolette (UV) est une autre option écologique pour prévenir la croissance microbienne.
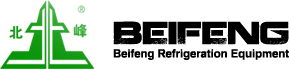
 简体中文
简体中文









.jpg?imageView2/2/w/300/h/300/format/webp/q/75)


